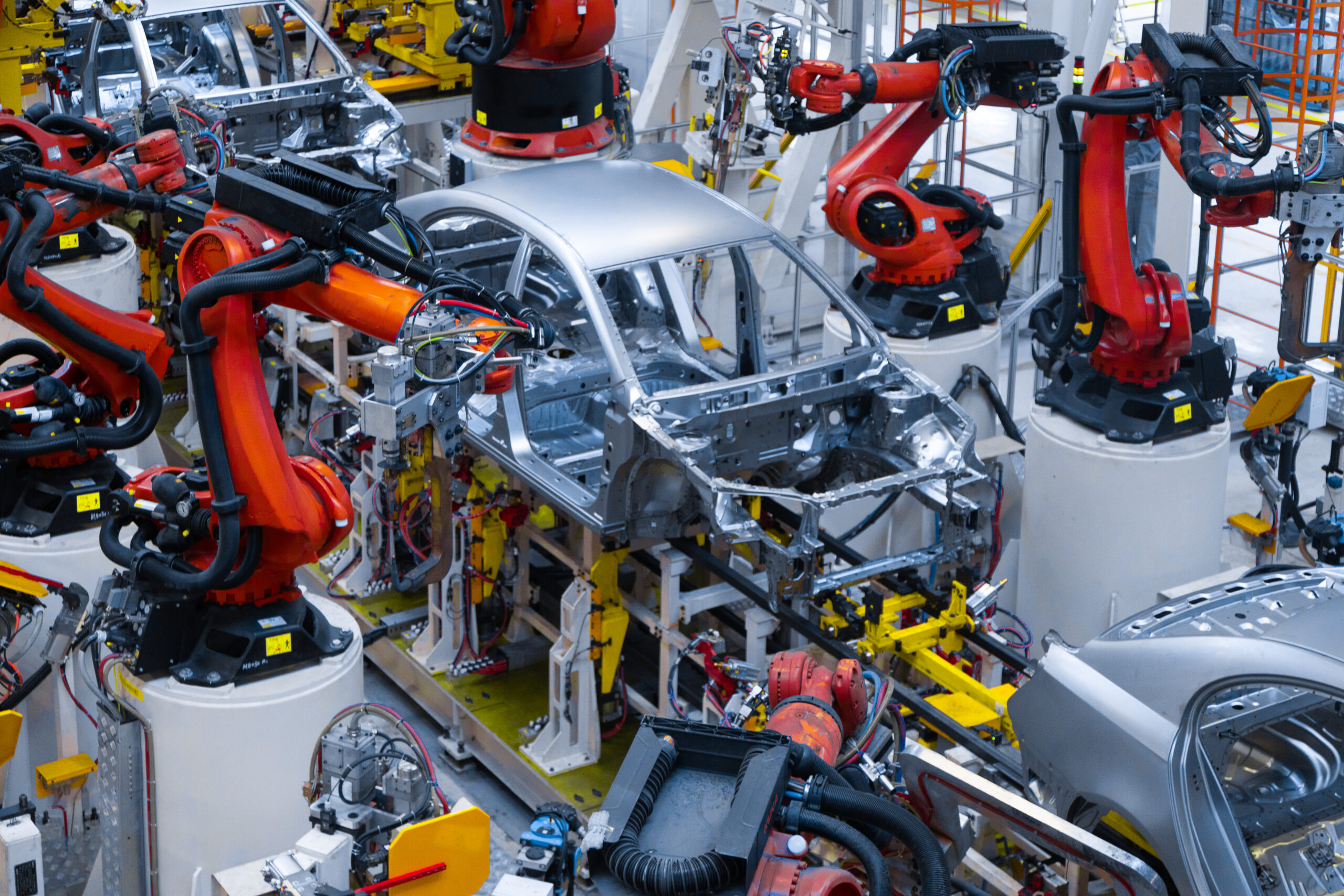RH : face à la crise d’engagement dans les PME, l’intelligence artificielle au service de l’humain ?

Dans les petites et moyennes entreprises, la gestion des ressources humaines n’a plus rien d’un concept abstrait. Peu dotée, pressée par le quotidien et contrainte par un cadre réglementaire exigeant, elle navigue désormais entre urgences administratives, tensions sociales et arbitrages délicats. Au moment même où les attentes en matière de reconnaissance, de sens et de qualité de vie au travail n’ont jamais été aussi fortes, la fonction RH peine à absorber la charge.
De ce constat est née Modjo Gaia, une solution créée par l’ancienne DRH Marjorie Pigaux. Son ambition : offrir aux dirigeants de TPE et PME une fonction RH externalisée, flexible, disponible à la demande — et augmentée par l’intelligence artificielle, sans renoncer à la profondeur du contact humain.
Une fonction RH sous-dimensionnée
Pour Marjorie Pigaux, les entreprises doivent aujourd’hui composer avec un paradoxe : « On attend d’un RH qu’il réponde aux dirigeants, aux managers et aux collaborateurs, alors que les moyens ne suivent pas. Pour tenir la fonction, il faudrait beaucoup plus de ressources. » Dans de nombreuses PME, le pilotage RH est compressé au profit des activités productives. Parfois jusqu’à disparaître.
Les conséquences peuvent se révéler coûteuses. Les économies de court terme réalisées en supprimant un poste RH peuvent se transformer en litiges sociaux onéreux, en tensions internes ou en départs non anticipés de salariés clés. Des signaux faibles que les entreprises ne perçoivent pas toujours tant la charge opérationnelle capte l’attention.
Un contre-pouvoir discret mais essentiel
La fondatrice de Modjo Gaia insiste sur un point : la fonction RH n’est pas qu’un support administratif. Elle incarne aussi un « tiers de confiance », capable d’alerter, de tempérer les décisions managériales et de rappeler les conséquences humaines d’arbitrages parfois hâtifs. Dans un environnement sous tension, ce rôle de stabilisation devient stratégique : garde-fou juridique, soutien aux managers et repère humain.
Difficile d’imaginer que l’IA puisse remplacer cette dimension. « Une IA mal conçue ne remplira jamais cette fonction de contre-pouvoir », souligne Marjorie Pigaux. Chez Modjo Gaia, la technologie vient plutôt prolonger l’action humaine, en absorbant les tâches répétitives et en assurant une continuité de présence.
Externalisation et assistance 24/7
Modjo Gaia fonctionne d’abord comme une cellule RH externalisée, joignable à toute heure. Son avantage : intervenir en prévention comme en gestion de crise, avec un recul que la fonction interne ne peut pas toujours mobiliser.
L’entreprise a choisi d’intégrer l’IA sous forme « d’alter ego », des assistants conçus pour seconder les RH et managers, et non pour s’y substituer. Leur architecture repose sur trois étages : un socle métier humain, une couche technique d’outils et de processus, et une couche augmentée destinée à faciliter la prise de décision ou le suivi opérationnel.
Un exemple illustre cette approche : l’entretien annuel. L’alter ego peut assister au rendez-vous, structurer les échanges, vérifier les obligations légales et fournir un débrief au manager — sans jamais mener lui-même l’entretien.
Du recrutement à la QVT : changer le diagnostic
Modjo Gaia refuse par ailleurs d’aborder les difficultés RH par le seul prisme du recrutement. Derrière la notion souvent invoquée de « pénurie de talents », l’entreprise voit fréquemment un problème d’alignement stratégique ou culturel. « Les organisations où vision, pratiques et culture convergent ont très peu de mal à attirer », observe la fondatrice.
Le diagnostic implique d’aller sur le terrain. Les dirigeants ne perçoivent pas toujours ce qui se joue dans l’entreprise au-delà des symboles de modernité — espaces de travail design, machines à café ou avantages périphériques. Le véritable engagement se construit autour de la cohérence et de la communication interne.
L’intégration de l’IA vise enfin à améliorer durablement la qualité de vie au travail. « Notre enjeu est de réduire la charge mentale liée aux relations humaines au travail », résume Marjorie Pigaux. Dans un contexte où la technologie est encore massivement pensée comme levier d’optimisation ou de réduction des coûts, Modjo Gaia défend une autre voie : celle d’une IA partenaire, au service de la performance durable et de la cohésion sociale.