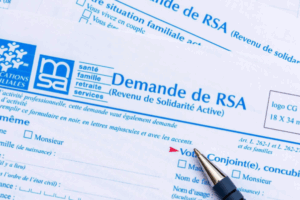L’Iran menace de fermer Ormuz, 20 % du pétrole mondial en jeu

Téhéran réplique aux frappes américaines en brandissant la menace d’un blocus du détroit d’Ormuz. Une riposte qui pourrait bouleverser l’économie mondiale.
Ormuz, passage étroit aux enjeux géostratégiques démesurés
Le détroit d’Ormuz, long de 55 kilomètres, sépare l’Iran des Émirats arabes unis. Il relie le golfe Persique à l’océan Indien par le golfe d’Oman. Chaque jour, des dizaines de pétroliers, cargos et méthaniers y transitent. Ce couloir maritime est vital non seulement pour le pétrole, mais aussi pour le gaz naturel liquéfié. Y passent également les exportations de pays clés : Koweït, Irak, Qatar.
20 % du pétrole mondial y transite, représentant près de 600 milliards de dollars de valeur par an. À cela s’ajoute un tiers du gaz naturel liquéfié (GNL) mondial. En menaçant d’y bloquer la navigation, l’Iran active une bombe économique à fragmentation lente mais certaine. En cas de fermeture, ce sont des dizaines de pays dépendants de ces flux qui seraient touchés de plein fouet.
Ce n’est pas la première fois que la République islamique agite la menace de fermeture d’Ormuz. Déjà en 2011 et en 2019, à la suite de tensions militaires avec les États-Unis, l’Iran avait multiplié les exercices navals dans la zone. En 2025, la menace prend toutefois une tout autre dimension : elle survient juste après des frappes américaines directes sur des sites nucléaires, dans un contexte de tension extrême.
Une onde de choc immédiate sur les marchés pétroliers mondiaux
Lundi 23 juin, les marchés ont immédiatement réagi. Le baril de Brent atteint 79 dollars, le WTI 81 dollars. Soit une hausse de 15 à 20 dollars en un mois. Un bond brutal, conséquence de la fébrilité des marchés face à un risque de blocage durable. Ormuz est un goulet : s’il se ferme, aucun itinéraire alternatif ne peut absorber un tel volume de brut et de gaz.
Certains analystes rappellent le précédent de 2008, où le baril avait culminé à 140 dollars. Ce pic, supérieur à ceux de 1973 et 1979, fut alimenté par une guerre d’usure sur les approvisionnements. La menace iranienne ranime ce spectre. L’inconnue demeure toutefois la réaction des membres de l’OPEP+, en particulier l’Arabie saoudite et la Russie, qui pourraient adapter leur production.
L’impact ne se limite pas au pétrole. Le c (GNL), composante stratégique de la transition énergétique, transite lui aussi en partie par Ormuz. Une interruption même partielle aurait des effets directs sur les marchés asiatiques et européens. L’approvisionnement de l’Inde et du Japon serait fortement perturbé, fragilisant aussi leur économie.
Une bombe à retardement pour les économies européennes
La flambée des prix à la pompe ne sera pas immédiate, mais elle est inéluctable si le prix du baril continue à monter. L’été 2025 pourrait voir les tarifs exploser, alimentant une tension sociale déjà vive. Le souvenir de 2018 et de la crise des Gilets jaunes hante encore les esprits : tout choc pétrolier est désormais redouté par l’exécutif français.
La France n’a plus les marges de manœuvre budgétaires de 2022. Son niveau de dette et la faiblesse de sa monnaie rendent toute politique de compensation difficile. Le gouvernement ne pourra probablement pas reproduire le bouclier tarifaire ou la remise carburant. L’achat du baril en dollar aggrave la donne, d’autant que l’euro est au plus bas face à la devise américaine.
Face à ce risque, l’Union européenne devra accélérer sa stratégie de diversification énergétique. Mais à court terme, elle reste vulnérable. Les stocks stratégiques ne couvrent que quelques mois de consommation. La transition énergétique, encore inaboutie, rend l’Europe particulièrement exposée aux aléas du marché fossile. Le scénario d’un prix du baril à 120 voire 140 dollars n’est plus exclu par les économistes.