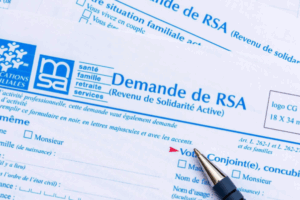1er juillet : hausse du gaz, bonus auto et réforme santé
Revalorisation du chômage, bonus écologique renforcé, obligations en cas de canicule… Le 1er juillet 2025 marque l’entrée en vigueur de nombreux changements concrets.
Santé, sécurité et travail : l’État muscle son arsenal
Afin de lutter contre la fraude aux indemnités journalières, l’Assurance maladie impose désormais un formulaire Cerfa ultra-sécurisé pour tout arrêt-maladie prescrit à domicile. Dès ce 1er juillet, seuls les originaux comportant hologrammes, encre magnétique et identifiant du médecin seront recevables. Les copies et documents scannés seront systématiquement refusés. La mesure intervient après un bond des fraudes, passées de 17 à 42 millions d’euros en un an, et vise à restaurer la confiance dans le système d’indemnisation.
Employeurs, salariés et représentants du personnel doivent désormais composer avec un dispositif strict de prévention des risques liés à la chaleur. Dès la vigilance jaune, les employeurs doivent adapter horaires et tâches, fournir trois litres d’eau fraîche par jour, installer ventilateurs ou brumisateurs, et équiper les salariés (chapeaux, lunettes, vêtements respirants). Les postes doivent être repensés pour limiter l’exposition aux rayonnements, et les pauses allongées. Ce tournant réglementaire impose à tous les secteurs une culture de la prévention plus rigoureuse.
La lutte contre le tabagisme prend une nouvelle tournure. Dès le 30 juin, il est interdit de fumer dans les parcs, plages, abris de bus, abords des écoles, stades ou piscines, sans laisser cette décision à la libre appréciation des communes. Cette extension vise à réduire l’exposition au tabagisme passif, notamment pour les enfants. Si certaines villes pionnières, comme Nice, appliquaient déjà ces mesures, leur généralisation nationale symbolise une volonté claire de changer les comportements au quotidien.
Pouvoir d’achat et emploi : des hausses, mais timides
Les allocataires du chômage verront leur indemnité journalière légèrement augmenter de 0,5 %, avec un nouveau minimum à 32,13 euros. Une hausse certes modeste, mais qui concernera plus de deux millions de personnes. À Mayotte, l’allocation minimale s’établit désormais à 16,05 euros. Cette revalorisation, automatique pour les salaires de référence datant d’au moins six mois, s’inscrit dans la continuité des ajustements de 2024, mais reste bien en deçà de l’inflation constatée sur les produits de première nécessité.
Un forfait de 750 euros s’appliquera désormais aux entreprises embauchant un apprenti de niveau bac+3 et plus. Cette contribution sera perçue directement par les centres de formation. Par ailleurs, les modalités de prise en charge des formations évoluent : les frais ne seront plus calculés au mois commencé, mais proratisés selon les jours réellement travaillés. Une réforme visant à responsabiliser davantage les employeurs et à réduire les abus sur les contrats courts.
Bonne nouvelle pour les familles : les verres correcteurs conçus pour ralentir la progression de la myopie chez les enfants de 5 à 16 ans (comme les Miyosmart du groupe Hoya) seront désormais partiellement remboursés par la Sécurité sociale. Recommandés depuis 2022 par la Haute Autorité de santé, ces verres coûtent souvent plusieurs centaines d’euros. Cette mesure sanitaire, attendue de longue date, vise à rendre les dispositifs de prévention visuelle plus accessibles à toutes les familles.
Énergie et transition : l’État ajuste ses leviers
Le tarif d’acheminement du gaz augmente de 6,1 % à partir du 1er juillet, entraînant une hausse moyenne de 1,4 % sur les factures. Pour les foyers utilisant le gaz pour la cuisson et l’eau chaude, l’abonnement annuel passe à 117,93 euros (contre 114,30 euros). Pour ceux utilisant le gaz pour le chauffage, la facture grimpe de 277,43 à 290,83 euros. Cette revalorisation, justifiée par les coûts d’infrastructure, alimente toutefois les tensions sur le pouvoir d’achat des ménages, déjà mis à rude épreuve.
Le financement du bonus écologique pour l’achat de véhicules électriques bascule vers les certificats d’économie d’énergie (CEE), dans une logique de « pollueur-payeur ». Résultat : une aide en hausse pour les ménages modestes (jusqu’à 4 200 €), et de 3 100 € pour les autres, selon les revenus. Ce coup de pouce s’ajoute aux critères existants (prix maximal de 47 000 €, masse inférieure à 2,4 t, score environnemental minimum). L’objectif ? Poursuivre l’électrification du parc automobile sans grever le budget de l’État.
Avec ce nouveau mode de financement du bonus auto via les CEE, l’État transfère une partie du coût de la transition énergétique vers les fournisseurs d’énergie. Ces derniers doivent financer les économies d’énergie réalisées par les ménages, entreprises ou collectivités. Cette logique incitative renforce le rôle des acteurs économiques dans les politiques publiques environnementales. Mais elle pose aussi une question d’équité : les aides dépendent désormais de la capacité des fournisseurs à orienter efficacement leurs budgets.