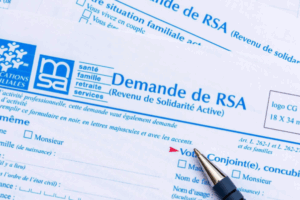Intermarché reprend 81 magasins Colruyt en France

Le Groupement Les Mousquetaires (Intermarché/Netto) s’engage à acquérir 81 supermarchés et 44 stations-service Colruyt pour 215 M€, avec transfert de 1 300 salariés.
Une opération stratégique majeure dans la distribution
Le 17 juin 2025, le groupe belge Colruyt a annoncé avoir reçu une promesse unilatérale d’achat émanant du Groupement Les Mousquetaires, maison-mère des enseignes Intermarché et Netto. Cette proposition porte sur l’acquisition de 81 supermarchés intégrés sur les 104 magasins Colruyt en France, ainsi que sur 44 stations-service DATS 24. L’opération est estimée à 215 millions d’euros, confirmant une stratégie offensive du groupement français pour consolider son maillage territorial, en particulier dans l’Est et le Centre-Est du pays. Pour Colruyt, ce retrait partiel marque un recentrage de ses activités sur des marchés plus rentables.
Les points de vente concernés sont majoritairement implantés dans les régions du quart nord-est, de la Bourgogne-Franche-Comté à la Lorraine. L’accord comprend également la reprise de plusieurs plateformes logistiques stratégiques, bien que certains entrepôts soient exclus de la transaction pour des raisons d’incompatibilité avec le modèle des Mousquetaires. L’ensemble représente une opportunité pour Intermarché d’accélérer son expansion tout en optimisant la répartition de ses flux. Au total, plus de 1 300 salariés sont concernés par le transfert, prévu pour le premier semestre 2026.
Colruyt, présent en France depuis 1998, fait face à des difficultés structurelles sur le territoire hexagonal. Malgré une activité rentable sur certains points, la filiale française du distributeur belge a enregistré un déficit supérieur à 20 millions d’euros au titre de l’exercice 2024-2025. Le poids des frais fixes, conjugué à une dynamique concurrentielle très tendue dans le secteur, a poussé le groupe à envisager une sortie partielle. L’accord avec Les Mousquetaires permet ainsi de limiter les pertes tout en garantissant une transition équilibrée.
Un transfert socialement encadré
L’un des piliers de l’accord repose sur la transmission intégrale des contrats de travail des salariés concernés, en vertu de l’article L1224-1 du Code du travail. Ainsi, 1 316 salariés de Colruyt Retail France rejoindront les entités du Groupement Les Mousquetaires sans rupture de contrat. Les 175 postes non transférés dans les entrepôts seront compensés par des propositions de CDI à pourvoir dans les structures logistiques des Mousquetaires, à l’issue d’une procédure de reclassement. Cette méthode témoigne d’une volonté commune de privilégier l’emploi et d’éviter les licenciements secs.
Avant tout transfert opérationnel, une consultation des instances représentatives du personnel (IRP) sera engagée. Ce dialogue, obligatoire dans le cadre d’une cession de cette ampleur, vise à préciser les modalités d’intégration, les perspectives de carrière, et les conditions de travail dans les nouvelles entités. Le PDG de Colruyt Retail France, Stefan Goethaert, a assuré que l’objectif était de garantir une intégration harmonieuse et responsable, dans l’intérêt conjoint des salariés et des enseignes concernées.
Les magasins repris seront confiés à des adhérents-indépendants du Groupement Les Mousquetaires, selon le modèle coopératif traditionnel de l’enseigne. Ces chefs d’entreprise bénéficieront d’un accompagnement personnalisé pour assurer la transformation logistique, marketing et RH des points de vente. Cette architecture décentralisée favorise une réappropriation locale des commerces et pourrait, selon les analystes, faciliter l’ancrage territorial durable des ex-magasins Colruyt.
Recomposition du paysage concurrentiel
Le secteur de la grande distribution en France est soumis à une concurrence intense, marquée par la montée en puissance du e-commerce, la pression sur les prix, et la prolifération des enseignes de hard-discount. Dans ce contexte, la reprise de Colruyt par Les Mousquetaires permet à ces derniers de conforter leur troisième place sur le marché français, derrière Leclerc et Carrefour. L’objectif affiché du Groupement : atteindre 20 % de parts de marché à l’horizon 2028, en renforçant sa présence dans les zones moins couvertes.
Cette acquisition s’inscrit dans une stratégie plus large de croissance externe, amorcée dès 2023 avec le rapprochement d’Intermarché et de Casino sur plusieurs zones de chalandise. Le modèle coopératif des Mousquetaires leur permet d’agir avec agilité, en s’appuyant sur un réseau dense de points de vente tout en gardant une gouvernance décentralisée. L’intégration des magasins Colruyt s’effectuera dans cette logique, avec une conversion progressive aux standards logistiques et commerciaux du groupement.
Enfin, cette opération envoie un message fort aux distributeurs européens : la France, marché historiquement dense, reste une zone complexe pour les enseignes étrangères peu implantées. L’exemple de Colruyt, contraint de se replier après près de 25 ans de présence, révèle les difficultés à atteindre une taille critique sans réseau logistique robuste et connaissance fine du tissu local. Pour Les Mousquetaires, cette reprise vient donc également confirmer leur statut de consolidateur national.