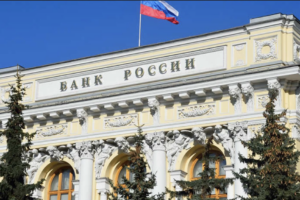Le commerce équitable à la française connaît un essor sans précédent

Le label Agri-Ethique a bouclé une année 2024 exceptionnelle, marquée par une croissance spectaculaire des ventes et des produits référencés. Le commerce équitable, longtemps associé aux pays du Sud, trouve désormais un solide ancrage dans les territoires agricoles français.
Pain, miel, yaourts, chips… Ces produits familiers des rayons de supermarché sont de plus en plus nombreux à arborer un label de commerce équitable d’origine hexagonale. Et le phénomène prend de l’ampleur. En tête de cette dynamique, Agri-Ethique, pionnier du commerce équitable « made in France », vient d’annoncer des résultats record pour l’année 2024, avec des ventes en hausse de 75 % et un tiers de nouvelles références supplémentaires.
Une croissance portée par la fidélité aux territoires
Selon les chiffres communiqués par le label, les produits estampillés Agri-Ethique ont généré 911 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2024, avec un total de 1 050 références. Ces performances témoignent d’une véritable accélération du commerce équitable d’origine française, qui ne se limite plus à un segment marginal. Plus de 4 600 agriculteurs – répartis sur 1 800 exploitations – sont désormais impliqués dans ce modèle, conçu pour garantir des revenus stables et prévisibles.
Le fonctionnement repose sur des contrats pluriannuels, d’une durée minimale de trois ans, liant agriculteurs, transformateurs et distributeurs. L’objectif est clair : lutter contre la volatilité des marchés agricoles et offrir aux producteurs une visibilité à long terme. Cette approche, inspirée par les pratiques de commerce équitable Sud/Nord, trouve ici une application concrète aux réalités françaises.
Une réponse aux dérives du marché mondialisé
Agri-Ethique n’est pas né par hasard. Le label a vu le jour en 2014, initié par une coopérative agricole de Vendée, dans le sillage de la crise économique de 2007-2009. Cette période avait mis en lumière la vulnérabilité des producteurs français face aux fluctuations des marchés mondiaux, notamment dans le secteur des céréales. Il fallait trouver un moyen de sécuriser les revenus des exploitations en créant des circuits plus courts, plus stables, et plus solidaires.
Aujourd’hui, cette initiative locale est devenue une référence nationale. Des marques emblématiques comme Brets pour les chips ou Labeyrie pour les produits à base de canard ont récemment rejoint l’aventure. Leur engagement témoigne de l’attractivité croissante du modèle : il ne s’agit plus seulement de responsabilité sociétale, mais aussi d’une stratégie d’approvisionnement fiable et durable.
Une nouvelle façon de consommer local
« On ne parle pas seulement de consommation responsable, on parle de stabilité financière et de vision de long terme », insiste Ludovic Brindejonc, directeur du label. Pour lui, l’engouement des consommateurs pour les produits Agri-Ethique reflète une mutation en profondeur des attentes citoyennes. Fini le temps où l’équitable se cantonnait aux bananes ou au chocolat importé. Aujourd’hui, il est aussi question de farine, de lait ou de confitures produites à quelques kilomètres du domicile.
La progression du commerce équitable français ne se limite pas à Agri-Ethique. D’autres labels, comme Bio Équitable en France, se développent également, avec des cahiers des charges similaires. L’ensemble de ces initiatives repose sur la création de filières organisées, transparentes et durables. Dans un contexte de transition agricole et alimentaire, elles permettent aux exploitations françaises de gagner en résilience, tout en répondant à une demande croissante de produits locaux, sains et éthiques.
Vers une généralisation du modèle ?
Le succès rencontré par Agri-Ethique semble indiquer que le commerce équitable français a franchi un cap. Ce n’est plus une niche, mais une tendance de fond. Pour les marques, c’est aussi une opportunité de se différencier, à l’heure où les consommateurs scrutent de plus en plus la traçabilité, la rémunération des producteurs et l’impact environnemental de leurs achats.
Ce modèle peut-il s’étendre à l’ensemble de l’agriculture française ? Si des freins subsistent – notamment en termes de structuration de certaines filières ou de coût pour le consommateur –, les bases posées par les labels existants offrent une perspective crédible. En conjuguant équité, souveraineté alimentaire et transparence, le commerce équitable « origine France » a sans doute encore de beaux jours devant lui.