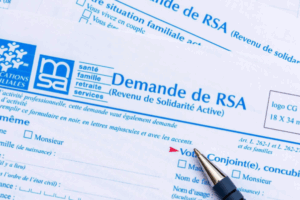Fin des privilèges à vie pour les anciens Premiers ministres

Dès 2026, voiture, chauffeur et protection policière des ex-chefs de gouvernement seront limités dans le temps, annonce Sébastien Lecornu.
La fin d’un régime de faveur hérité de la Ve République
Depuis des décennies, les anciens Premiers ministres bénéficiaient d’un dispositif exceptionnel : un véhicule avec chauffeur et un secrétariat particulier, attribués sans limite de temps. Une tradition qui s’est installée sous la Ve République, dans le sillage des privilèges accordés aux anciens présidents. Si elle se voulait une reconnaissance du service rendu à l’État, cette pratique apparaissait de plus en plus anachronique dans une époque marquée par la rigueur budgétaire et l’exigence de transparence.
En 2024, la prise en charge de ces avantages a coûté 1,58 million d’euros à l’État. Un montant modeste rapporté à la dette publique de 3 300 milliards, mais comparable aux dépenses annuelles liées aux anciens présidents (1,32 million en 2023). La facture dépend des situations individuelles : certains ex-chefs du gouvernement n’y recourent pas ou peu, tandis que d’autres mobilisent des moyens bien plus importants. Ces écarts nourrissent le sentiment d’injustice et relancent les critiques d’une opinion publique sensible au symbole plus qu’au montant.
Le décret de 2019 avait déjà limité certains avantages, notamment la mise à disposition d’un secrétaire particulier, arrêtée à 67 ans. Mais la règle ne s’appliquait qu’aux ministres quittant leurs fonctions après 2019. Ainsi, les plus anciens continuaient d’y avoir droit jusqu’en 2029, créant une disparité entre générations de responsables politiques. Pour l’entourage de Sébastien Lecornu, cette situation ne pouvait perdurer sans accentuer le fossé entre citoyens et élites.
Les mesures annoncées par Sébastien Lecornu
Dès le 1er janvier 2026, les anciens Premiers ministres conserveront le droit à un véhicule avec chauffeur, mais seulement pour une durée de dix ans après leur départ de Matignon. L’accès à un secrétariat particulier restera encadré par le décret de 2019, avec une limite d’âge de 67 ans. L’objectif affiché par le chef du gouvernement est clair : mettre fin à des avantages perçus comme « à vie » et les inscrire dans une logique de service limité dans le temps.
Autre évolution majeure : la protection rapprochée, jusque-là attribuée sans limite de durée aux anciens Premiers ministres et ministres de l’Intérieur, sera désormais bornée. Elle sera fixée à trois ans pour les premiers et deux ans pour les seconds, avec possibilité de reconduction en cas de menace avérée. Une instruction adressée à la DGPN doit établir ce nouveau cadre, rompant avec une « tradition républicaine non écrite » qui garantissait une sécurité permanente.
Pour Sébastien Lecornu, il n’est « pas concevable » qu’un statut temporaire comme celui de Premier ministre puisse justifier des privilèges perpétuels. L’annonce s’inscrit dans une stratégie politique double : afficher une volonté de rationaliser la dépense publique et répondre à une opinion de plus en plus critique à l’égard des avantages accordés aux responsables politiques. Ce discours de fermeté vise à redonner crédit à l’action gouvernementale dans un contexte budgétaire contraint.
Une réforme à portée symbolique mais politiquement sensible
Le gain budgétaire attendu reste marginal : quelques millions d’euros par an au maximum. Les opposants à la réforme soulignent que l’impact sur le déficit public est insignifiant. Mais pour ses partisans, la mesure ne doit pas être jugée uniquement à l’aune comptable : elle traduit une volonté d’exemplarité et d’alignement avec les exigences de sobriété imposées au reste de la population.
Tous ne sont pas logés à la même enseigne. Jean Castex, devenu président de la RATP, n’a coûté que 4 225 euros en 2024. Édouard Philippe et Laurent Fabius n’ont rien coûté à l’État cette année-là, du fait de leurs fonctions publiques respectives. À l’inverse, Dominique de Villepin et Bernard Cazeneuve ont représenté les postes de dépenses les plus lourds, dépassant chacun 190 000 euros. Ces disparités nourrissent l’idée que la réforme, en introduisant un cadre uniforme, apportera une plus grande équité.
Au-delà des chiffres, c’est l’image d’un privilège attaché aux élites politiques qui est remise en cause. Dans une démocratie en quête de légitimité, réduire les avantages des « ex » participe d’une volonté de rétablir un lien de confiance avec les citoyens. Mais la réforme pourrait aussi susciter des résistances silencieuses dans les rangs des anciens Premiers ministres et ministres, peu enclins à voir leurs garanties rognées. La bataille est autant symbolique que pratique : elle questionne la manière dont la République remercie ses serviteurs tout en restant fidèle à l’exigence d’égalité.