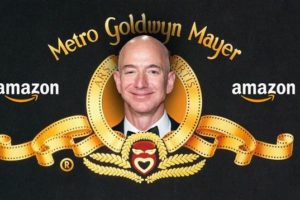AlloVoisins lance l’Abonnement Premier pour développer la visibilité et la croissance des professionnels

|
AlloVoisins, l’application de prestations de services et de location de matériel préférée des Français, a pour ambition de devenir le premier partenaire des artisans, indépendants, auto-entrepreneurs et autres professionnels, en les accompagnant dans la croissance de leur activité. Après avoir rassemblé une communauté de presque 4 millions de membres et séduit 300 000 professionnels, AlloVoisins fait évoluer son offre pour ces derniers avec le lancement de son Abonnement Premier, un abonnement mensuel sans engagement qui transforme les profils professionnels en une véritable vitrine web de leur savoir-faire et stimule rapidement leur activité. La marketplace met en exergue leur profil en l’enrichissant avec de nouveaux éléments et leur offre la possibilité d’être référencés prioritairement sur des moteurs de recherche comme Google pour leur assurer une plus grande visibilité auprès de leurs clients et prospects habitant près de chez eux.
“Avec plus de 300 000 professionnels membres, notre marketplace a su séduire les professionnels qui ont accès à des milliers de demandes quotidiennes postées sur la marketplace, de la demande de dépannage aux travaux les plus complexes, en passant par les services à la personne. Nous souhaitons aujourd’hui devenir le 1er apporteur d’affaires des professionnels en leur proposant les outils nécessaires pour développer leur business.” déclare Edouard Dumortier, co-fondateur d’AlloVoisins
Un abonnement clé en main proposé aux professionnels
AlloVoisins fait évoluer son abonnement à destination des professionnels en lançant son Abonnement Premier, une offre plus complète et plus intuitive dotée d’un nouvel espace Pro offrant une visibilité augmentée. Les Abonnés Premier sont désormais référencés prioritairement sur les pages de résultats disponibles via Google, attirant un nombre de clients supérieurs aux professionnels n’ayant pas souscrit à l’offre. Ils ont également la possibilité d’ajouter jusqu’à 50 photos de réalisation à leur galerie, classées par domaine d’expertise afin d’apporter davantage d’attractivités au site.
Dans cette continuité et pour accompagner au mieux la reprise de leur activité, les professionnels auront la possibilité dès juillet d’éditer leurs propres cartes de visite, prospectus ou flyer directement sur la marketplace. Des évolutions significatives pour les professionnels qui auront l’opportunité de gérer l’ensemble de leur activité sur une même marketplace, mais qui ne modifie en rien le prix de leur abonnement qui inclut ces nouveautés et celles à venir dès 29,90€/mois.
Des profils modernisés désormais référencés sur les moteurs de recherche pour une meilleure visibilité
Les profils des professionnels évoluent, se transformant ainsi en sites Internet. Plus modernes et attractifs, ils deviennent une véritable vitrine du savoir-faire des professionnels. Avec une interface désormais beaucoup plus intuitive et agréable à parcourir, les Voisins peuvent en un clic visualiser la biographie, le domaine d’expertise, les réalisations ou encore les avis laissés sur les profils des professionnels.
L’autre nouveauté proposée aux professionnels est le référencement de leur profil sur les moteurs de recherche comme Google avec une URL personnalisée. En complétant tous les champs requis et en soignant leur profil, les professionnels optimisent ainsi leur référencement, augmentant de ce fait leur visibilité sur la toile.
Enrichis d’une biographie, les profils des professionnels sont désormais plus complets. Les professionnels peuvent en effet intégrer un titre ou un métier à leur profil et peuvent désormais répondre aux commentaires laissés par les Voisins dans l’onglet avis et évaluations. Pour rendre l’offre des professionnels plus complète, le profil AlloVoisins s’est muni de nouveaux champs tels que les informations légales (SIRET, code APE, effectifs…), le numéro de téléphone, les disponibilités, une grille tarifaire et promotionnelle, les assurances liées à l’activité du professionnel et enfin les diplômes et certifications des professionnels. Avec ces nouveautés clé en main, AlloVoisins entend devenir l’étendard des professionnels pour leur offrir un espace fonctionnel, générateur de croissance.
À propos d’AlloVoisinsAlloVoisins est la plus grande marketplace française dédiée aux prestations de services et à la location de matériel, rassemblant une communauté de 3,8 millions de membres, dont 300 000 professionnels, qui génère 1,2 millions de demandes postées par an. De la demande de dépannage ou de services à la personne aux travaux les plus complexes, en passant par la location de matériel, AlloVoisins permet en quelques minutes d’activer l’ensemble des professionnels et habitants à proximité, susceptibles de répondre à tout type de besoins. Intermédiaire de confiance, la marketplace AlloVoisins favorise avant tout une approche gagnant/gagnant en s’appuyant sur les habitants et professionnels de nos quartiers. Animé au quotidien par une équipe passionnée et déterminée, AlloVoisins promeut un nouveau mode de consommation local, responsable et bienveillant. Contact Presse Nicolas Ruscher – nicolas.ruscher@antidox.fr – 06 63 05 72 73 |
|